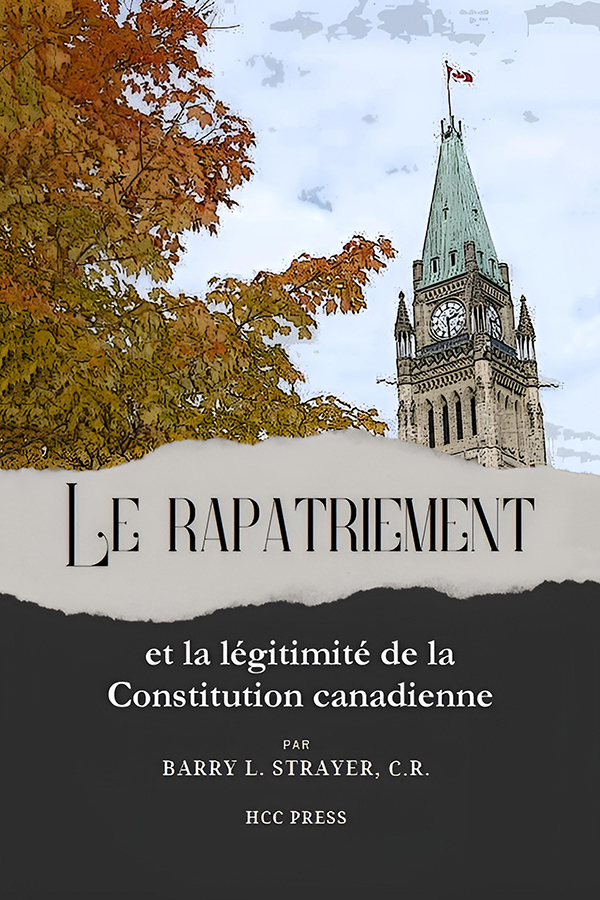Je n’insisterai pas davantage sur les différences entre la légitimité juridique et la légitimité politique. Je souhaite simplement rappeler que les deux sont importantes et qu’elles coexistent normalement, mais qu’à long terme, c’est la légitimité politique qui est la plus importante. Une fois que la légitimité politique d’une constitution est établie et que le régime qu’elle prescrit devient le système de gouvernement effectif, ce n’est qu’une question de temps avant que les tribunaux ne la reconnaissent en général ; sa légitimité juridique suivra alors.
S’agissant maintenant de la constitution canadienne, quelles sont les sources de sa légitimité, juridique et politique ? Je me propose de répondre à cette question en fonction des différentes périodes de notre histoire. Alors que la source de la légitimité juridique est restée constante jusqu’à cette année, je vais suggérer que les sources de la légitimité politique ont changé de temps en temps et peuvent encore changer. Dans cette analyse, je vais me concentrer sur la période allant de la Confédération à aujourd’hui.
La légitimité et la Confédération
La légitimité juridique de la Confédération a été fournie par le Parlement du Royaume-Uni. Bien que le pouvoir de ce Parlement de légiférer pour les colonies d’outre-mer ait été vivement contesté par certains, en particulier dans les colonies américaines, le point de vue judiciaire a été clairement énoncé par Lord Mansfield en 1774 dans la célèbre affaire Campbell v. Hall,4 lorsqu’il a déclaré que
un pays conquis par les armes britanniques devient un Dominion du Roi au droit de sa Couronne, et donc nécessairement soumis au pouvoir législatif du Parlement de Grande-Bretagne.
C’est sur la base de cette théorie que le Parlement a adopté, la même année, l’Acte de Québec et plusieurs autres actes dits “intolérables” — c’est-à-dire dénoncés par les colons américains — qui ont contribué à déclencher la révolution américaine. L’un des principaux griefs des treize colonies était que le Parlement britannique s’arrogeait le droit de légiférer à leur place, imposant ainsi une “taxation sans representation”. Dans les colonies du Nord, l’autorité législative du Parlement britannique n’a jamais été sérieusement remise en question et, bien entendu, l’Acte de Québec de 1774 a été généralement bien accueilli dans cette colonie. Il s’agit de la première d’une série de constitutions adoptées par le Parlement britannique pour le Canada, dont la Loi constitutionnelle de 1982 est la dernière. Ainsi, en 1867, lorsqu’il s’agit de remplacer les constitutions coloniales antérieures et de reconstituer un pays, personne ne doute sérieusement que le Parlement du Royaume-Uni puisse légalement adopter l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.
La légitimité politique de cet acte est moins facile à expliquer. Pourquoi cette nouvelle constitution, adoptée par un parlement lointain pour lequel aucun Nord-Américain britannique ne pouvait voter, était-elle acceptable dans ce pays ? Il n’y avait pas de
4. (1774) 1 Cowp. 204; 98 E.R. 1045 (K.B.).