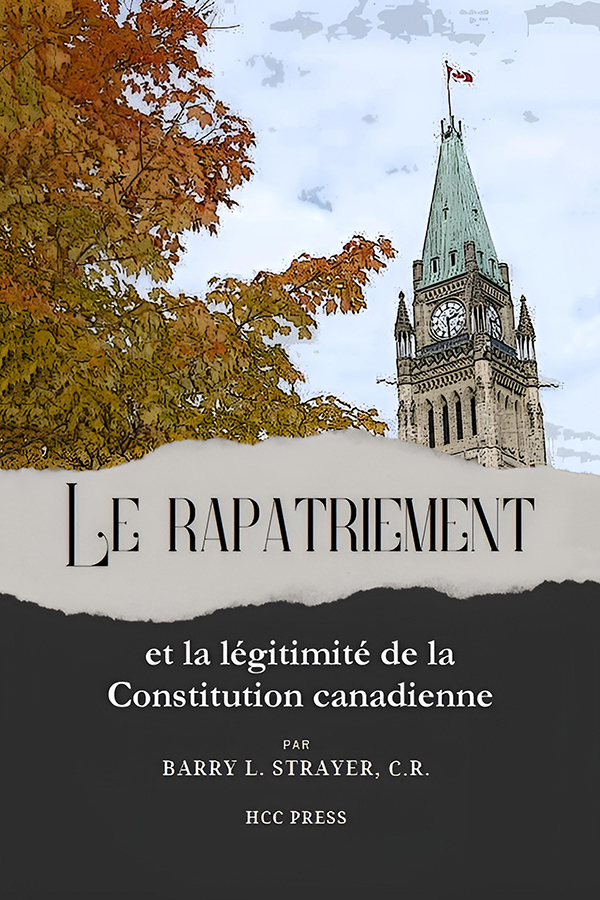dire ! Mais je peux au moins conclure que dans huit provinces, l’approbation des assemblées législatives n’a pas été considérée comme une composante essentielle de la légitimité politique de ces amendements constitutionnels.
La Cour suprême du Canada
Passons à un autre acteur important du drame constitutionnel, la Cour suprême du Canada.
Tout au long de cette période, la presse a largement soutenu l’idée de soumettre toute la question à la Cour suprême pour qu’elle décide si le processus de rapatriement et d’amendement était adéquat ou non.18
Il semble que le gouvernement fédéral n’ait pas été très enthousiaste à l’idée de soumettre cette question à la Cour suprême ; il ne l’a jamais fait, bien qu’il soit le seul à avoir le pouvoir de prendre un renvoi direct.
Les gouvernements provinciaux dissidents — la “bande des huit” — semblaient avoir une approche quelque peu ambivalente du contrôle juridictionnel. Pour les provinces opposées à l’ancrage d’une Charte, qui craignaient de confier aux tribunaux l’élaboration des politiques publiques, il semblait incohérent de saisir les tribunaux pour régler ce qui était essentiellement une question politique. Certains représentants provinciaux, alors que les affaires étaient pendantes devant les tribunaux, ont averti que les décisions judiciaires ne pouvaient vraiment pas résoudre le problème et que, même si la loi était du côté du gouvernement fédéral, cela ne devrait pas régler la question. Après la décision de la Cour suprême, cependant, ces mêmes représentants des deux côtés de la question ont semblé embrasser les divers jugements de la Cour pour le confort qu’ils pouvaient en tirer.
Je voudrais faire deux observations sur le rôle ultime de la Cour suprême. Premièrement, je pense qu’il est indubitablement vrai que l’arrêt de la Cour suprême a eu un effet décisif sur l’issue de la conférence des premiers ministres qui a suivi en novembre 1981. À ce moment-là, j’assistais à ces conférences depuis environ vingt et un ans et j’ai été frappé par le ton différent de la réunion de novembre 1981. Pour la première fois, il était clair que l’unanimité n’était pas nécessaire pour parvenir à un accord. Il était clair, d’une part, que le gouvernement fédéral pouvait légalement agir sans le consentement de la majorité des provinces. D’autre part, il était clair que si un accord substantiel des provinces n’était pas obtenu, le jugement des six juges de la Cour Suprême sur la question des conventions constitutionnelles pourrait être utilisé avec un effet considérable
18. Voir, par exemple, “The Constitution and the Court”, Toronto Globe and Mail, éditorial, 15 octobre 1980 ; “Court test has merit”, Ottawa Citizen, éditorial, 15 octobre 1980 ; “Send constitution to Supreme Court”, Montreal Gazette, éditorial, 16 octobre 1980 ; “How our system works”, Financial Post, éditorial, 10 janvier 1981 ; Richard Gwyn, chronique, Toronto Star, 5 février 1981.