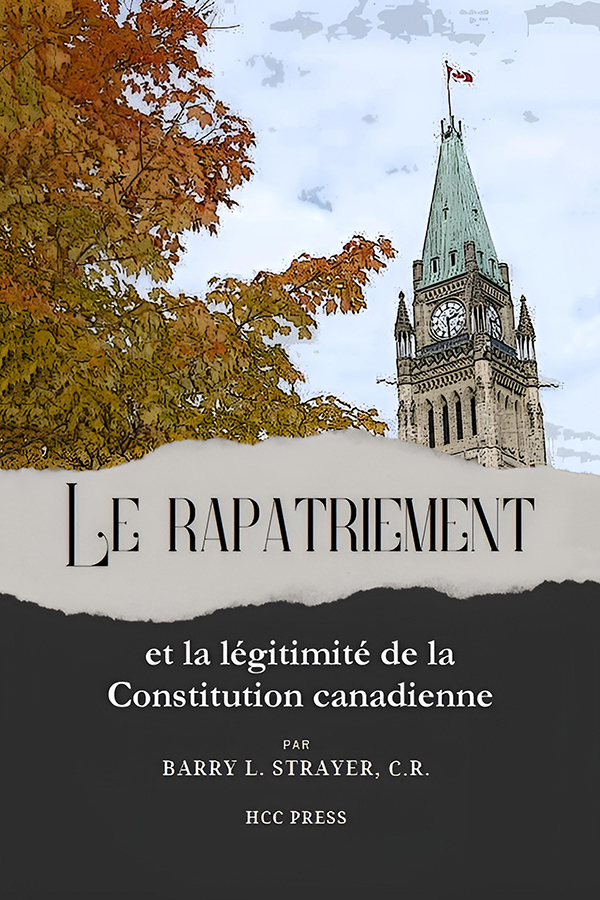Dans cette analyse, j’avoue avoir été influencé il y a longtemps par Hans Kelsen et sa théorie de la grundnorm. Selon Kelsen, pour comprendre un système juridique, il faut trouver la norme ou la règle de base qui détermine l’élaboration des lois. Il n’est pas nécessaire de connaître la source de cette règle de base, c’est-à-dire de savoir si elle est un acte de Dieu ou de l’homme. Il suffit de savoir qu’elle fonctionne. Normalement, toute loi ou constitution adoptée conformément à cette règle de base ou grundnorm est légitime, mais seulement si l’ensemble du système juridique est efficace. S’il cesse d’être efficace, c’est-à-dire s’il n’est plus reconnu ou accepté par les personnes qu’il est censé gouverner, la simple légitimité juridique formelle ne le sauvera pas et il sera probablement remplacé par un autre système généralement acceptable et donc efficace. En d’autres termes, la légitimité politique est essentielle ; la légitimité juridique est souhaitable mais pas nécessaire. En d’autres termes, rien ne réussit mieux que le succès.1 Contrairement à de nombreux philosophes du droit, Hans Kelsen a été largement cité dans les tribunaux, en particulier dans les pays du Commonwealth où les juges ont dû faire face à des coups d’État, des révolutions et d’autres discontinuités juridiques dans le gouvernement. Comme vous pouvez l’imaginer, il a été d’un grand réconfort pour l’esprit judiciaire lorsqu’il a fallu reconnaître de nouveaux gouvernements qui jouissaient d’une certaine légitimité politique mais n’avaient pas de légitimité juridique.
On peut donc avoir une constitution tout à fait respectable même si elle n’est pas juridiquement légitime. Deux exemples permettent d’illustrer ce propos. Tout d’abord, la constitution britannique et la monarchie. Au risque d’être accusé de trahison, je pourrais affirmer qu’en droit, notre véritable monarque est un obscur descendant des Stuart jacobites. Si l’on remonte à la Glorieuse Révolution de 1688, lorsque Jacques II a quitté le pays et que les Anglais ont mis sur le trône Guillaume et Marie de la Maison d’Orange, ce n’était pas du tout dans les règles. Si cela s’était produit en 1980, les dix provinces canadiennes auraient saisi leurs cours d’appel à ce sujet ! Le fait est qu’un changement dans la succession au trône a été autorisé par un Parlement qui n’a pas été convoqué selon les règles préexistantes et dont la décision n’a pas reçu la sanction royale parce qu’il n’y avait pas de souverain sur le trône pour la donner. Mais cela a fonctionné. À partir de cette origine illégitime, le Parlement britannique régit depuis lors la succession au trône. Rien ne réussit mieux que le succès, et qui contesterait aujourd’hui la légitimité politique de la Constitution britannique ? 2
Deuxièmement, considérons la Constitution américaine. Quelle constitution est aujourd’hui plus éminemment respectable, plus sanctifiée par les peuples qu’elle régit ? Mais sur le plan juridique, elle porte la barre sinistre. Elle est du mauvais côté de la
1. Voir, par exemple, Kelsen, General Theory of State and Law (1945), p. 115-23.
2. Voir Maitland, Constitutional History of England (1908) 281-88; Taswell-Langmead, English Constitutional History, Plucknett, éditeur, 10e éd. 1949), p. 491-521.