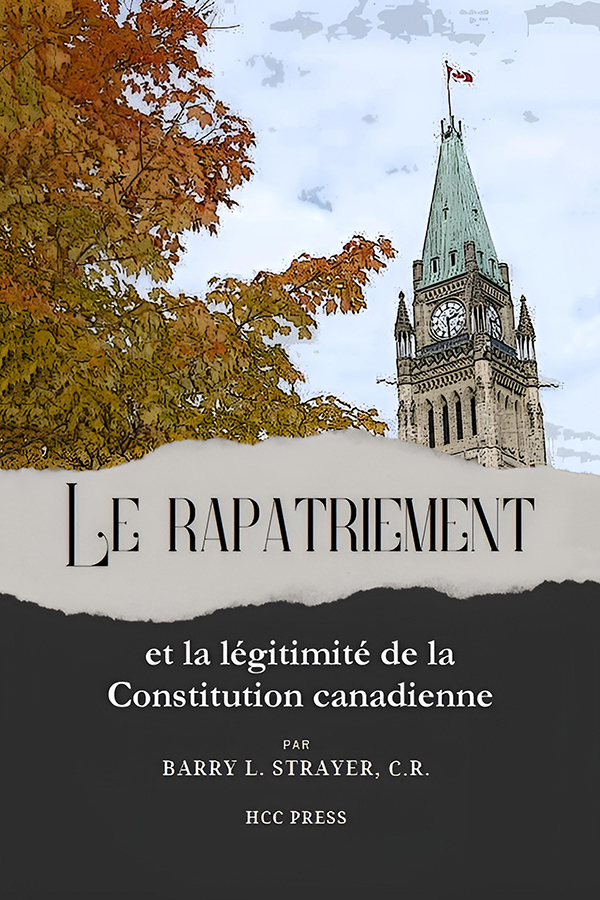D‘autre part, le Parlement avait de nombreux détracteurs qui qualifiaient d’“unilatéralisme” toute décision sur la constitution prise par les deux chambres.13 Une version plus sophistiquée de cette critique était que le Parlement ne devait pas procéder de cette manière sans un mandat du peuple, obtenu soit par une élection au cours de laquelle la question était soulevée, soit par un référendum.14
On pourrait également conclure que les membres du Parlement eux-mêmes avaient des doutes sur le rôle de cette institution dans la modification de la Constitution. Vous vous souviendrez qu’en avril 1981, tous les partis au Parlement se sont mis d’accord pour ne pas procéder à un vote final sur l’Adresse conjointe avant que la Cour suprême n’ait entendu les appels des renvois provinciaux sur la question de savoir si le processus employé était ou non conforme à la loi et aux conventions de la constitution. Quelles que soient les raisons, les faits objectifs sont que le Parlement n’a pas procédé à l’approbation finale avant que la Cour suprême n’ait déclaré qu’il serait conforme aux conventions de la constitution d’obtenir l’approbation substantielle des provinces et que l’accord de neuf gouvernements provinciaux n’ait été obtenu.
Une fois cet accord provincial obtenu, le Parlement, la presse et le public, du moins en dehors du Québec, ne se sont guère opposés à ce que le Parlement aille de l’avant.
13. Voir par exemple “Mr. Blakeney’s Task”, Toronto Globe and Mail, éditorial, 14 octobre 1980 ; “Une action d’une exceptionnelle gravité” Le Devoir, éditorial, 4 octobre 1980, p. 18.
14. “Pourquoi pas des élections, M. Trudeau ?” Le Devoir, 16 octobre 1980, p. 14 ; Prof. G. Rémillard, Proceedings of Special Joint Committee on the Constitution, 9 janvier 1981, 35:11.