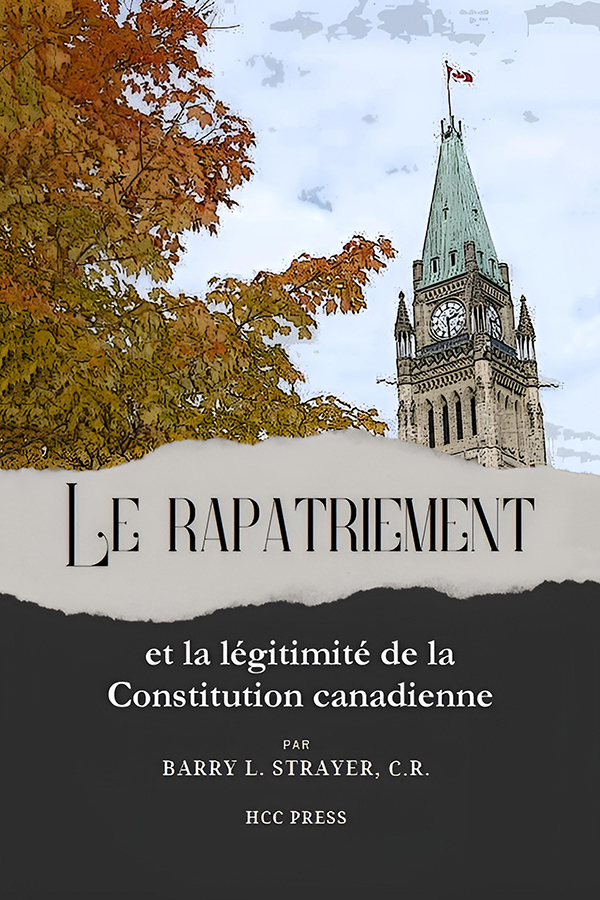et de soulever certaines questions quant à ce que nous pourrions apprendre de cette expérience sur la nature de notre système politique. J’espère que cela nous permettra de spéculer plus intelligemment sur la voie à suivre pour les futurs amendements constitutionnels. En procédant à cet examen, j’applique un critère essentiellement pragmatique : quelles approches de la légitimité politique semblent fonctionner dans notre pays ? Après tout, c’est le test que j’ai défini pour moi-même dans mon premier cours.
Tout d’abord, je suppose qu’il est naturel de se demander si le résultat de tous ces efforts, la Loi de 1982 sur le Canada, est politiquement légitime. Je ne peux que souligner certains indicateurs. Il est évident que le gouvernement fédéral et les neuf gouvernements provinciaux qui ont signé l’accord en novembre dernier considèrent leur travail comme politiquement légitime. Il en va de même pour le Sénat et la Chambre des communes qui ont adopté le discours commun. Il en va probablement de même pour les assemblées législatives des neuf provinces consentantes, car je n’ai pas entendu dire que l’une d’entre elles ait mis son gouvernement en échec sur cette question. Dans la mesure où l’on peut juger de telles choses, il semble également qu’une majorité de Canadiens accepte la nouvelle constitution. Selon un sondage Gallup réalisé en mai 1982, 57% des personnes interrogées au niveau national pensaient que la nouvelle constitution était une bonne chose, 14% seulement pensaient qu’elle n’était pas une bonne chose et 30% ne savaient pas. Bien que le degré d’enthousiasme varie d’une partie du pays à l’autre, il n’y a aucune région, pas même le Québec, où une majorité s’oppose à la nouvelle constitution.9 D’autre part, le gouvernement du Québec et une majorité de son Assemblée nationale ne considèrent manifestement pas un changement constitutionnel comme politiquement légitime sans le consentement du gouvernement du Québec. Ce gouvernement a soumis à sa Cour d’appel la question de savoir si une modification apportée en dépit du veto du Québec est conforme à la convention constitutionnelle ; ce faisant, il demandait si une telle modification était politiquement légitime. La Cour d’appel du Québec a répondu par l’affirmative et cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour suprême du Canada, qui n’a pas encore rendu sa décision.10
Tout au long de ce processus agonisant, des attitudes différentes ont été manifestées à l’égard de l’autorité avec laquelle divers organes, groupes ou personnes peuvent prendre des décisions concernant la constitution. Je pense que ces attitudes révèlent certains points de vue, certains articulés et d’autres inarticulés, quant aux sources de légitimité politique de notre constitution, et je souhaite examiner plusieurs de ces sources possibles.
9. “Close to one third of Canadians unsure if new constitution good” Ottawa Citizen, 19 juin 1982, p. 4.
10. Depuis ces conférences, le 6 décembre 1982, la Cour suprême a jugé que le Québec n’avait pas de droit de veto conventionnel : P.G. du Québec c. P.G. du Canada (1982) 45 N.R. 317.