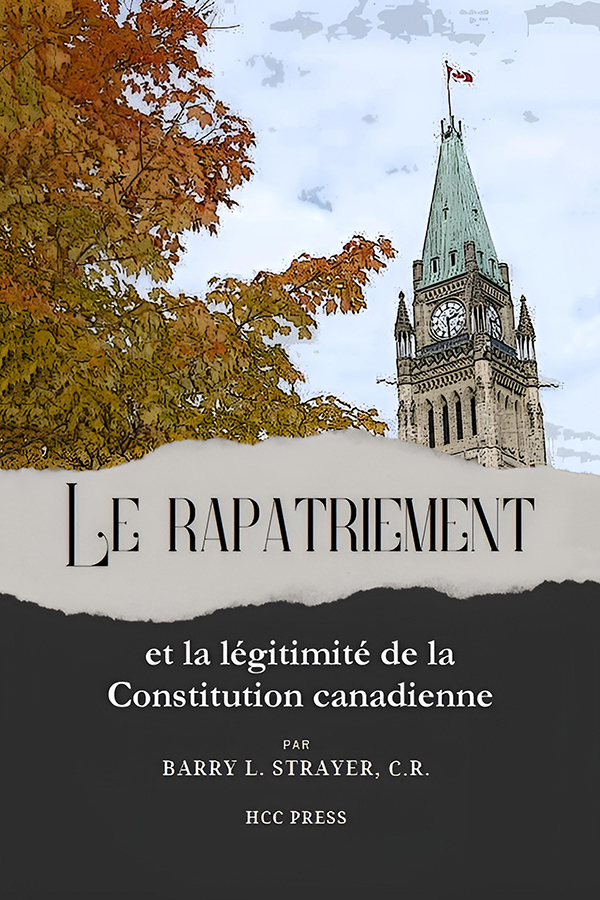respectant l’éminence de mes deux prédécesseurs, je pense qu’il est juste de suggérer que je jouis d’une distinction qu’ils n’ont pas, à savoir que j’ai été l’étudiant du doyen Cronkite.
J‘ai choisi pour ces conférences le titre général “Rapatriement et légitimité constitutionnelle”. Au cours des deux dernières années, notre pays a subi un traumatisme constitutionnel au cours duquel nous avons vu les anciens mécanismes juridiques de modification de la constitution canadienne abandonnés en Grande-Bretagne et leurs remplaçants mis en place au Canada. Je souhaite examiner des questions telles que la manière dont cela a été fait légalement et si cela a été efficace sur le plan juridique. Je souhaite également soumettre à votre réflexion certaines questions générales concernant les processus politiques impliqués dans l’élaboration de la constitution et la manière dont ils sont liés à l’acceptabilité politique de la constitution. Ces différents aspects du processus de rapatriement et d’amendement sont appelés légitimité juridique et légitimité politique.
Avant de me lancer dans ce qui pourrait être considéré comme une aventure dangereuse, un mot d’abord de la part de celui qui ne m’a pas parrainé. Bien que les opinions qui suivent soient les miennes et pas nécessairement celles du gouvernement du Canada, je ne peux pas me défaire entièrement de mon statut de fonctionnaire fédéral. Vous comprendrez donc que je pose certaines questions sur les attitudes et les positions du public non pas dans le but d’engager une controverse politique mais, je l’espère, pour stimuler la réflexion sur les véritables critères d’acceptabilité d’une constitution dans ce pays. Je poserai ces questions sans y répondre.
Pour commencer, un mot sur la “légitimité”. Lorsque je parle d’une constitution légitime, je parle d’une constitution qui fonctionne. Je suppose que cela fait de moi un pragmatique. Si, dans certaines parties du monde, il se peut que l’on fasse fonctionner les constitutions par l’usage de la force, pour ce qui me concerne, je parle de constitutions qui fonctionnent parce qu’elles sont généralement acceptées par les personnes qu’elles gouvernent. Comme je l’ai déjà suggéré, la légitimité a deux aspects : juridique et politique. Une constitution légalement légitime est une constitution qui a été adoptée ou modifiée par un organe ou un processus préexistant qui était légalement autorisé à adopter ou à modifier la constitution. En d’autres termes, si vous disposez d’un système juridique qui fournit les moyens d’élaborer ou de modifier la constitution et que vous adoptez des dispositions constitutionnelles conformément à ce processus, le produit final est juridiquement légitime, même s’il est très différent de la constitution précédente. Une constitution est politiquement légitime lorsqu’elle est généralement acceptée par les personnes qu’elle gouverne parce qu’elle a été adoptée ou modifiée par des personnes ou des organismes qu’ils acceptent généralement comme ayant le droit politique de décider de ces questions. Normalement, la légitimité juridique et la légitimité politique sont réunies dans toute constitution en vigueur. Mais il arrive que l’une ne soit pas accompagnée de l’autre, comme je le montrerai dans quelques instants. Dans ce cas, c’est la légitimité politique qui, à long terme, est déterminante pour la survie d’une constitution.