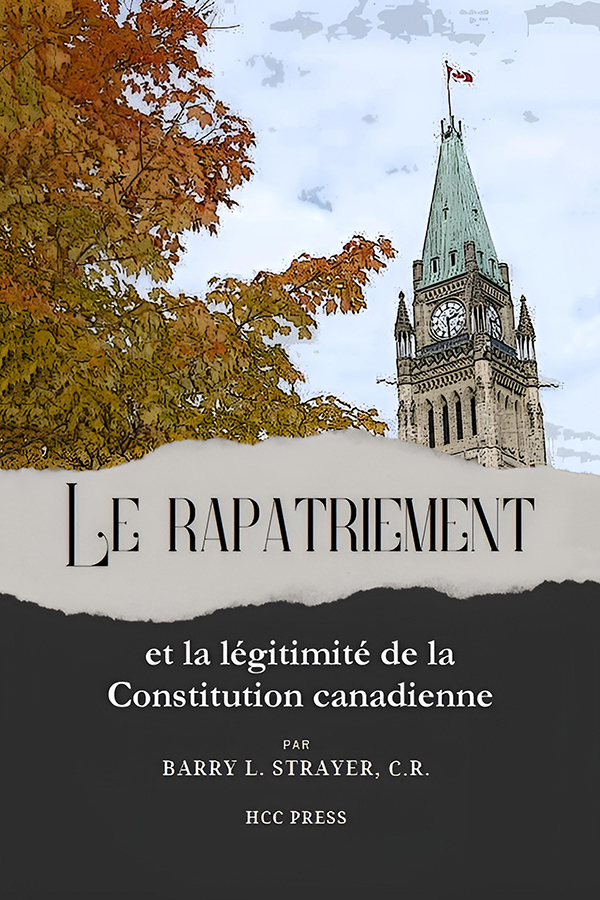ont commencé à discuter de la manière de concevoir une constitution qui serait “autochtone”, c’est-à-dire une constitution qui semblerait avoir germé sur le sol canadien. Nous avons élaboré un plan, avec des consultations fédérales-provinciales et des consultations à Londres avec des fonctionnaires britanniques, qui, selon nous, répondrait aux exigences légales sans impliquer que le Parlement du Royaume-Uni adopte de nouvelles dispositions constitutionnelles pour le Canada. Ce plan se présentait à peu près comme suit. Une fois l’accord obtenu à la Conférence de Victoria sur le texte de la Charte, celui-ci serait soumis aux assemblées législatives et aux deux chambres du Parlement canadien. Une fois la Charte approuvée par toutes ces instances, le Parlement britannique serait invité à adopter une courte loi mettant fin à son autorité sur le Canada. Cette loi reconnaîtrait également la validité de la Charte de Victoria comme ayant force de loi au Canada une fois qu’elle aurait été proclamée ici par le gouverneur général du Canada. En d’autres termes, la Charte ne figurerait nulle part dans la législation britannique et ne serait pas promulguée par le Parlement britannique. Après cette procédure à Londres, le gouverneur général du Canada émettrait une proclamation au Canada, mettant en vigueur la Charte constitutionnelle canadienne de 1971.
Nous savons aujourd’hui qu’en raison du rejet final de la Charte de Victoria par le Québec, ce processus n’a pas abouti. Il est cependant intéressant de revenir sur ce projet de rapatriement et de voir les priorités de l’époque. Une légitimité politique parfaite devait, vraisemblablement, être obtenue par l’approbation des assemblées législatives de toutes les provinces et des deux chambres du Parlement. Avec le soutien de toutes ces augustes instances, qui pourrait mettre en doute le fait qu’une telle Charte constitutionnelle était l’expression ultime de la volonté de tous les Canadiens ? Sur le plan juridique, cependant, même si le projet aurait presque certainement été accepté par les tribunaux, il n’offrait pas cette continuité parfaite que l’on associe à la légitimité juridique. En effet, les nouvelles dispositions constitutionnelles n’auraient pas été adoptées par l’organe habilité à modifier notre constitution. Elles auraient été le produit autochtone de onze organes législatifs canadiens et auraient simplement été reconnues par Westminster. Aussi mauvaise que cette approche ait été pour le rapatriement, je ne me souviens d’aucune critique sérieuse à son égard à l’époque, même si le contenu de la Charte de Victoria a fait l’objet de critiques sérieuses. On peut peut-être se risquer à conclure que le projet de rapatriement de l’époque pouvait se permettre d’être un peu faible sur le plan de la légitimité juridique parce qu’il allait être si richement doté en légitimité politique. Il s’agit peut-être d’une nouvelle illustration de ce que j’ai dit précédemment, à savoir que l’on peut toujours remédier à un peu d’anémie juridique avec une bonne dose de légitimité politique.