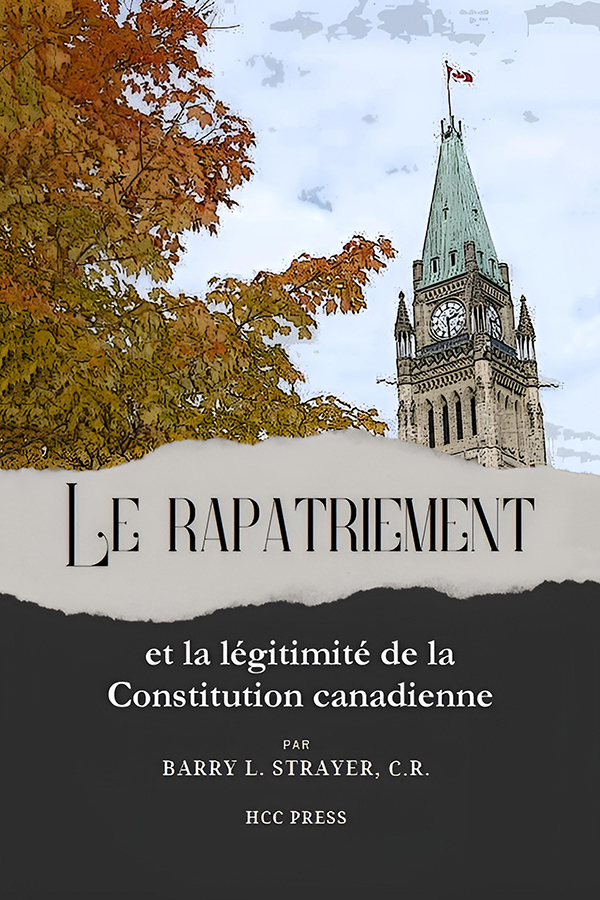Mais je m’écarte peut-être du sujet. Le point principal est qu’en 1967, on s’attendait généralement à ce que les provinces soient impliquées dans les amendements affectant certaines parties fondamentales de la constitution. La nature de ces éléments n’était pas définie, pas plus que le degré d’implication. De même, il n’y avait pas de définition définitive des moyens par lesquels le consentement des provinces serait donné aux amendements lorsque ce consentement était requis. Il s’agit d’une question fondamentale à laquelle on n’a accordé que très peu d’attention au fil des ans. Comme je l’ai mentionné précédemment, il a été clairement établi, dès le dix-neuvième siècle, qu’au niveau fédéral, les amendements ne pouvaient pas être demandés à Londres simplement par le pouvoir exécutif du gouvernement canadien, et que l’approbation devait être donnée par le Sénat et la Chambre des communes. La démocratie n’a pas été poussée à de telles extrémités dans les provinces, cependant, lorsqu’elles ont commencé à être consultées sur les amendements constitutionnels. Pour autant que je puisse en juger, avant 1951, dans les cas où les provinces donnaient leur accord préalable aux amendements, cet accord n’était donné que par le gouvernement exécutif de la province. En 1951, lors du premier amendement concernant les pensions de vieillesse, les assemblées législatives du Québec, de la Saskatchewan et du Manitoba ont donné leur approbation avant que leurs gouvernements n’acceptent l’amendement. En 1960, seule la législature du Québec a été consultée au préalable pour la modification concernant le mandat des juges. En 1964, encore une fois, seule la législature du Québec a été consultée. Pourtant, l’idée de consulter les législatures sur des questions aussi importantes semblait faire son chemin dans les processus des années 60 en vue de l’adoption d’une formule d’amendement. La formule Fulton de 1961 prévoyait que l’approbation des amendements par les provinces serait à l’avenir donnée par les législatures, tout comme la formule Fulton-Favreau de 1964. Comme indication de la conversion des provinces à ce concept révolutionnaire, on peut noter qu’en vue de son adoption, la formule Fulton-Favreau a été soumise aux législatures pour approbation par au moins sept gouvernements provinciaux et qu’elle a été dûment approuvée. Personne, bien sûr, n’a songé à aller plus loin pour obtenir une approbation politique en consultant réellement la population par le biais d’un référendum.
A la fin de cette période de soixante ans (1907-1967), nous constatons que la responsabilité politique des changements constitutionnels — une responsabilité dont il était bien établi au dix-neuvième siècle qu’elle incombait aux Canadiens — a été progressivement partagée entre les autorités fédérales et provinciales. Bien qu’aucune formule précise de modification de la Constitution canadienne n’ait encore été adoptée, l’attente politique générale était claire : toute formule de ce type devait prévoir un certain degré de consentement provincial et, en outre, aucune formule de ce type ne serait même adoptée au départ sans un large consentement provincial. La forme que prendrait ce consentement n’était pas encore définie, mais il y avait eu une certaine évolution dans le sens d’une approbation par les législatures provinciales, ainsi que par les gouvernements exécutifs, afin de se conformer à la pratique de longue date au niveau fédéral.